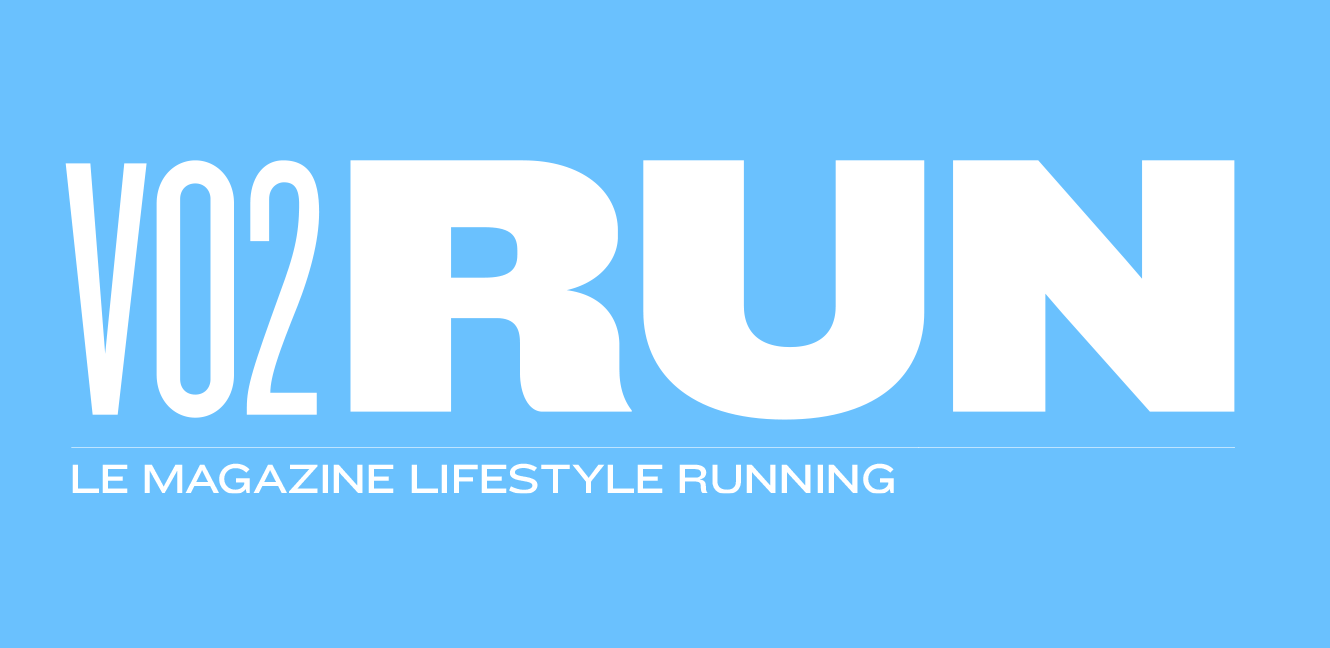Cécile Coulon : « Sans la course à pied, ma manière d’écrire serait très différente »

Cécile Coulon a publié en 2018 Les Ronces, recueil de poèmes pour laquelle elle vient de remporter le prestigieux Prix Apollinaire. L’occasion de (re)lire l’interview qu’elle nous avait accordée il y a deux ans, à propos de son quatrième roman, Le Coeur du Pélican.
« Mettez-vous en pièces pour les autres, défoncez-vous, faites craquer les squelettes, vendez-leur du rêve. Voilà ce que ça voulait dire : arrachez-vous la peau pour nourrir les espoirs des autres ».
Scandée par des métaphores aussi explosives qu’un départ de 100 mètres, Cécile Coulon raconte dans Le Cœur du Pélican avec une acuité confondante l’ascension d’Anthime, athlète promis aux plus grands succès sur 800 m, mais dont l’élan sera brisé par une vilaine blessure. Vingt ans plus tard, alors qu’il mène une vie insipide, Anthime reprend l’entraînement et va s’accomplir en parcourant la France…heureuse coïncidence avec la France en courant (lire page).
En filigrane, de son écriture affûtée comme un marathonien l’est après des centaines de kilomètres avalés, l’écrivaine de 26 ans au grand talent (qui a publié son premier roman…à 16 ans) dépeint la complexité des sentiments d’un être humain soumis aux feux des projecteurs tout en interrogeant les méandres de la gloire sportive et l’ambivalence d’un public bien trop volatile.
Cécile Coulon, qui « adore écrire sur le sport », véritable « vivier romanesque délaissé pendant longtemps », mène actuellement une thèse de littérature à Clermont sur le corps et le sport dans la littérature contemporaine française. Elle confie notamment pourquoi la course à pied, qu’elle a découvert à 15 ans et pratique 4 à 5 fois par semaine (« j’aime bien le semi-marathon et j’ai maintenant deux objectifs : rester sous les 50’ sur 10 km », barrière qu’elle a pour la première fois franchie cette année, et « courir un marathon »), lui est si indispensable.
Pourquoi avez-vous choisi de traiter ce thème, complètement différent de vos quatre autres romans ?
On a l’habitude de voir les Bleus qui gagnent à l’Euro ou Usain Bolt qui gagne les JO ; tout le monde se fout un peu du reste (rires). Je voulais parler de tous les sportifs que l’on ne connaît pas : tous ceux qui commencent, qui ont des petites carrières puis s’arrêtent, qui sont blessés, et comment ils s’en sortent ou ne s’en sortent pas.
Je suis dans une région assez rurale où les gens font du sport, où les associations sportives sont un lieu social par excellence, et quand j’ai commencé à écrire le roman, j’ai eu plein de témoignages de gens qui étaient des gloires locales, mais qui n’avaient jamais réussi à passer le cap du stade de foot du dimanche. Les gens engloutissent des années entières dans une passion en étant persuadés qu’ils vont avoir un statut, être athlète professionnel. Et en fait, non. Je trouve ça à la fois extrêmement dur et hyper touchant. 99% du sport n’est jamais montré à la télé. Il faut aller le chercher chez les gens pour le voir.
Vous êtes vous-mêmes passé par là ?
Non. Le sport a toujours fait partie de ma vie, j’ai toujours aimé en faire, mais je ne me suis jamais dit : “tiens, je vais passer douze heures par semaine dans une salle d’entraînement“.
Vous avez interviewé des sportifs ? Car la réalité des descriptions (sur les sentiments d’avant course, après une défaite etc…) dans le roman est frappante.
Non. Depuis que je suis toute petite, je regarde les Jeux Olympiques, les championnats du Monde et je suis allée à plusieurs meetings d’athlétisme. Je pense que le boulot d’écrivain, c’est aussi de sortir un peu de soi-même, en se demandant ce que le mec ou la nana peut ressentir quand il est sur la ligne de départ, et qu’il/elle sait pertinemment que parmi ses 5-6 concurrent(e)s, certain(e)s sont bien meilleur(e)s. Quand on est assez jeune en littérature, c’est exactement la même question qui se pose. Pas au niveau physique, car ce n’est pas une performance physique. En rentrée littéraire, on est 500, certains ont gagné le Goncourt : comment on fait nous ?
« On a l’impression que les gens transfèrent tous leurs rêves, tous leurs fantasmes sur un athlète »
C’est donc l’imagination qui rentre en ligne de compte ?
Carrément. L’imagination fait 90% du travail. Enfin, pour moi ce n’est pas du travail, car le sport n’est pas une plongée dans l’inconnu. Mais j’avais envie de passer par la petite porte : voilà ce qui peut se passer quand quelqu’un qui est promis à un avenir qu’il imagine très grand se casse en fait la gueule avant même de briller. Je crois que j’avais surtout envie de dire que le sport local, familial, prend parfois une ampleur qui pousse tout le reste.
Quel être votre vision du sport, justement ? Le roman apporte un regard plutôt sombre.
J’ai une image extrêmement positive du sport en tant que tel. Par contre, j’ai une image assez négative des médias car on voit toujours les mêmes athlètes. En ce moment, tout le monde se tape des Jeux Paralympiques (l’interview a été réalisée début septembre, ndlr). Je trouve qu’un athlète qui va courir un 200 m sans jambes est autrement plus à applaudir qu’un mec qui a ses jambes. Cela peut paraître un peu réac, mais je trouve ça fou l’indifférence qu’il y a autour des Jeux Paralympiques.

D’autre part, on a l’impression -c’est ce que je dis dans le roman- que les gens qui ne sont pas des sportifs et regardent le sport transfèrent tous leurs rêves, tous leurs fantasmes sur un athlète. Si un athlète gagne on l’adore ; s’il perd on le déteste. Je trouve ça horrible, c’est un être humain quoi.
Pour moi, un vrai fan est quelqu’un qui soutient un athlète dans la défaite. On sait qu’il faut faire avec le grand public, mais on oublie totalement les années de souffrance et de sacrifice des athlètes.
Vous semblez avoir un mélange d’admiration et d’incompréhension envers les sportifs de haut niveau ?
Oui, généralement, ça va ensemble. Quand j’étais enfant, j’avais une vraie passion pour Paula Radcliffe (recordwoman du Monde du marathon, ndlr). Je me souviens qu’elle avait eu es problèmes intestinaux pendant un marathon, comme Yohann Diniz. Et les gens l’ont humilié après ça, en reprenant les images etc…
En tant que spectatrice et supportrice, j’avais à la fois cette admiration pour les grands champions, et en même temps, je ne comprenais pas comment ils avaient pu affiner leur corps, en arriver là. Et je me disais : j’espère qu’ils font ça pour eux et pas pour les autres. Je voulais vraiment montrer dans le livre le sport est un prétexte pour le personnage principal : c’est quelqu’un qui a envie d’être au-dessus de la moyenne, qui ne supporte pas l’endroit où il est né, où il vit, et que pour lui le sport est une façon d’échapper à ça, de sortir de son milieu.
« Un éditeur, c’est un entraîneur, il sait comment parler à l’auteur, sait le pousser dans ses retranchements pour faire en sorte qu’il donne le meilleur de lui-même »
Y a-t-il un lien entre la course à pied et l’écriture ?
Honnêtement, je pense que l’un ne va pas sans l’autre. Quand on court, on réfléchit beaucoup, il y a une espèce de tri intellectuel qui se fait. La course à pied est vraiment un moment d’incubation. Quand je cours, je travaille en même temps à l’écriture : je me demande ce que je vais écrire, quels vont être mes personnages.
Sans la course à pied, ma manière d’écrire serait très différente. Je pense déjà que je serais sur les nerfs. Je suis persuadée que la course à pied affermit le mental. Je pense que les gens qui courent ont une tendance naturelle à vouloir se dépasser, se fixer des objectifs et être capable d’aller plus loin que ce qu’on attend d’eux. Cela m’a aidé à écrire des romans.
Dans Auportrait du coureur de fond, l’auteur japonais Haruki Murakami, qui ne peut écrire sans courir, dit : « l’essentiel est de savoir si vos écrits ont atteint le niveau que vous vous êtes assigné (…) A vous-mêmes, impossible de mentir ». C’est la même chose pour vous ?
Il y a un peu de ça. Je ne vais jamais m’arrêter de travailler sur un livre si je ne suis pas totalement satisfaite de ce que j’ai fait. Après, un phénomène se passe souvent bien après la publication du livre : on le relit et on se rend compte des erreurs qu’on a pu faire. Le vrai challenge, c’est de toujours donner, de livre en livre, un roman qui soit meilleur, plus étoffé, plus creusé.
Vous relisez souvent vos livres ?
Je le faisais ; maintenant un peu moins, car je n’arrête pas de me poser des questions. Mais c’est très bien de le faire parce que ça aide à évoluer, à se perfectionner. C’est comme un athlète qui regarde sa fin de course et voit les mouvements qu’il ne faut plus faire.
« Comme il y a un rythme dans la course à pied, il y a un rythme dans l’écriture »
Ça ne doit pas être facile de trouver l’équilibre pour que le roman soit davantage étoffé sans l’être trop ?
C’est le rôle de l’éditeur, qui a la distance que nous n’avons n’a pas. Quand je donne un livre, j’ai tellement travaillé dessus que je ne suis pas capable de voir ce qui ne va pas, de voir quels personnages sont assez forts ou trop pâles. Un livre, c’est un travail à plusieurs.
Il y a des frictions avec votre éditrice ?
Il y en a mais je pars quand même du principe qu’il faut accepter de publier un livre pour que les gens le lisent et s’approprient l’histoire. A partir de là, celle-ci ne nous appartient plus et chacun lit le texte comme il veut. Le boulot d’un éditeur est de faire en sorte que les gens qui lisent le livre puissent s’identifier, avoir des émotions. Un éditeur, c’est un entraîneur, il sait comment parler à l’auteur, sait le pousser dans ses retranchements pour faire en sorte qu’il donne le meilleur de lui-même.
Comment se travaille l’écriture, particulièrement incisive chez vous ?
C’est aussi une forme d’entraînement. Comme il y a un rythme dans la course à pied, il y a un rythme dans l’écriture, et on ne connaît ce rythme qu’en lisant à haute voix, où l’on se rend compte si tel ou telle métaphore fonctionne ou pas. Oui, il ne faut jamais arrêter de lire, pour avoir plus de vocabulaire, pour s’inspirer. Pour comprendre comment font les autres, tout simplement.
Comment accueillez-vous le succès de la critique ? Redoutez-vous la chute comme Anthime ?
Honnêtement, j’avais un peu peur de tout ça, même si j’étais bien sûr très contente car ça faisait vendre des livres, ce qui est vraiment agréable aujourd’hui vu l’état de la finance dans l’édition. Après, je vis encore à Clermont et pas à Paris : je ne passe pas ma vie dans les cocktails, les prix d’éditeurs…Et puis je suis extrêmement bien entourée, je viens d’une famille où il faut bosser, et quand on travaille on n’a pas le temps de voir les projecteurs. Maintenant, je trouve que c’est génial et que c’est une étape : le but n’est pas la gloire mais de s’en servir pour faire les prochains livres.
Le cœur du pélican, Cécile Coulon, Viviane Hamy, 240 p, 18 euros.
Interview parue dans le numéro 248 de VO2 Run.
Photos : Antoine Rozès.